L'Institut Paul Bocuse : favoriser les rencontres entre le monde de la recherche scientifique et le monde de la gastronomie

Interview de Hervé FLEURY
"Comment redonner du sens à l’acte de manger ?"
Interview de Olivier CHAVANON
<< Il existe une âpre concurrence pour l’interprétation légitime du passé >>.
Propos recueillis pour le Cahier Millénaire 3, n° 20 (2000), pp 2-3. Interrogeant le lien mémoire-identité de manière originale, le sociologue Olivier Chavanon (Université de Chambéry) met en lumière la fonction de l’occultation et de l’oubli dans la construction de toute mémoire collective.
Pouvez-vous nous dire comment et pourquoi, en tant que sociologue, vous travaillez sur la question de la mémoire ?
Nous vivons une époque où les appels au passé ne cessent de se multiplier et où la notion de mémoire connaît un succès important. Je n’entrerai pas ici dans le détail de ce phénomène. Simplement il faut avoir à l’esprit que nos contemporains se soucient de plus en plus de ce que les anglo-saxons nomment les roots (les racines). Notre époque se caractérise de ce point de vue là par une véritable passion pour tout ce qui l’a précédée. Cela se voit à travers, par exemple, le regain de popularité de l’histoire auprès du grand public qui la consomme depuis les émissions de télé jusqu’aux revues spécialisées. Cela se voit à travers le culte grandissant porté aux archives, comme l’a souligné Pierre Nora. Cela se voit dans la multiplication des opérations de “patrimonialisation”, ou bien encore dans l’engouement absolument stupéfiant pour la généalogie, une discipline qui a vu le nombre de ses pratiquants passer de trois cents à plus de quarante mille en une trentaine d’années seulement !
Bref nous vivons dans une société « assoiffée de mémoire » pour reprendre les termes de J.P. Rioux. Cette quête quasi permanente et parfois, il faut le dire, un peu obsessionnelle de tout ce qui a trait au passé, ne peut pas laisser le sociologue indifférent. Elle pose d’abord la question des causes profondes de ce phénomène. Ensuite elle invite à réfléchir sur la fonction sociale actuelle de la mémoire pour les individus ou pour les groupes. Mais pour ma part, mon travail m’a souvent conduit à me pencher davantage sur le corollaire de la mémoire : l’amnésie. Car paradoxalement, la production de mémoire, la fabrication des souvenirs ne va pas sans engendrer des oublis, des occultations. Par définition, la mémoire est sélective. C’est vrai chez l’individu mais c’est tout aussi vrai à l’échelle des groupes. Elle opère des tris, des mises en forme du passé. Elle choisit des emblèmes. Et s’arrêter sur les pleins de la mémoire ne me semble pas suffisant. Les zones d’ombre, les trous noirs, les trous de mémoire ont aussi leur importance et leur signification.
Notamment, au cours de mes recherches, j’ai pu m’apercevoir que tous les groupes, selon la position qu’ils occupent dans l’espace social ne manifestent pas la même capacité à faire mémoire et à imposer leurs souvenirs sur la scène publique.
En réalité, il existe une âpre concurrence pour l’interprétation légitime du passé et chaque collectivité lutte pour imposer sa propre vision des choses.
Cette rivalité conduit parfois à l’éradication des mémoires minoritaires ou trop contradictoires avec celles que le groupe dominant entend véhiculer. Pour illustrer ce processus, on peut bien sûr prendre l’exemple des sociétés totalitaire où la mémoire d’État, censée être la seule valable, phagocyte toutes les autres. Ceci étant, dans nos sociétés pluralistes ce phénomène existe également, quoique de façon plus diffuse et invisible. Certes il n’y a pas des agents chargés d’orchestrer l’amnésie. Ce qui n’empêche nullement certains souvenirs collectifs de disparaître lorsqu’ils ne sont pas jugés comme étant assez valorisants pour la communauté.
D’où cette tendance qui me pousse toujours à me demander quelle est la face cachée de la mémoire, à me demander autrement dit dans quelle mesure l’arbre de la mémoire cache la forêt des amnésies…
Pour vous la mémoire ne se comprend qu’en couple avec l’amnésie. Il s’agit là des deux facettes d’un même processus. Mais alors en l’occurrence, quels sont d’après-vous les gros oublis qui sont un manque dans la compréhension de l’évolution historique de l’agglomération lyonnaise ainsi que dans sa réalité sociale d’aujourd’hui ?
Pour un sociologue, Lyon presque un “cas d’école”. En effet, il s’agit d’une ville qui a su valoriser certains aspects de son passé et qui a su construire une mémoire collective prégnante autour de quelques points forts de son histoire, même si parfois, ces points forts ont été un peu fabriqués pour les besoins de la cause si j’ose dire. Toujours est il que l’agglomération dans son ensemble distille aux différents étages de son système culturel un grand nombre de messages et de signes dont la fonction est de mettre les habitants en prise directe avec des morceaux du passé : Lyon capitale des trois Gaules ; Lyon capitale de la Renaissance ; Lyon capitale de la Résistance ; Lyon capitale de la gastronomie.
Or à Lyon, on ne peut être que frappé par le formidable décalage qui existe entre la richesse de ces éléments de la mémoire, qui sont largement survalorisés, et l’absence quasi totale de place accordée au souvenir de la présence étrangère (en dehors bien entendu de celle, très élitiste, des fameux banquiers florentins !). En effet cette ville fait partie de celles qui, en France, ont attiré le plus grand nombre de cohortes d’immigrants depuis l’avènement de l’industrialisation massive, c'est-à-dire en gros depuis 150 ans. La grande région lyonnaise est un territoire sur lequel un nombre très important de populations immigrées ont transité provisoirement ou se sont installées durablement. En fonction de la plus ou moins forte demande en main-d’œuvre liée au développement des industries locales, une grande variété de groupes y ont été attirés : Italiens, est Espagnols, Polonais, puis plus tard Portugais et Maghrébins, enfin Asiatiques et ressortissants d’Afrique noire. C’est la partie est-sud-est de l’agglomération rhodanienne qui a accueilli l’essentiel des colonies de travailleurs venus à partir de la fin du siècle dernier. Décines, Bron, Vénissieux, Saint-Fons, sont autant de villes qui se sont construites grâce à cet apport démographique considérable.
Des villes qui sans l’immigration ne seraient aujourd’hui que de simple petites bourgades. Je rappelle que dès la fin du XIXème siècle, les immigrés représentaient en France 15% de la classe ouvrière. Lorsque s’est produit, entre 1900 et 1930 le grand développement économique français, les étrangers constituaient un vecteur essentiel de l’essor industriel. D’ailleurs dans les années trente, la France était tout simplement le premier pays d’immigration au monde, devant les États-Unis, tout du moins en chiffres relatifs (c'est-à-dire rapportés à la population totale de l’hexagone). Et l’agglomération lyonnaise faisait déjà partie des zones les plus concernées. Il y a quelques jours, je lisais un article de l’INSEE expliquant qu’aujourd’hui sur le département, plus de 40% de l’accroissement démographique depuis 1946 est directement ou indirectement imputable à la présence des immigrés. Ce qui est considérable ! Mais la réalité de cette présence et de ce rôle historique prépondérant est largement passée sous silence. Nous avons d’ailleurs tout simplement perdu une partie de notre mémoire à ce sujet. Par exemple, les lieux qui ont accueillis les Italiens et les Espagnols dans les années trente ont disparus. J’ai travaillé pendant quatre ans, avec un ami sociologue du nom de Frédéric Blanc, sur le “Village Nègre”, un quartier immigré situé dans l’actuel huitième arrondissement de Lyon. Ce quartier logeait plus d’une centaine de familles et s’étendait sur plusieurs hectares sur une zone en déshérence foncière jouxtant la cité des États-Unis construite par Tony Garnier. A l’époque, il s’apparentait à un conglomérat de baraquements en bois, sans l’eau ni l’électricité, avec le toit en papier goudronné et le sol en terre battue. Ce quartier a existé entre les Deux-guerres. Il fut définitivement rasé à la veille de la Seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, sur son ancien emplacement, les habitants ignorent complètement son existence. En 1993, nous avions sollicité le journaliste Daniel Mermet pour qu’il réalise une émission sur le Village Nègre, en interrogeant d’anciens habitants. Des micro-trottoirs furent réalisés par ailleurs notamment sur le marché des “États”. Il s’est avéré que plus personne ou presque ne se souvenait de ce lieu. Le refoulement collectif avait fait son oeuvre. Le plus étonnant c’est que les archives que nous avons consultées pour en savoir plus étaient tout aussi muettes. Le seul document sur lequel nous avons réussi à mettre la main et qui atteste de l’existence du Village Nègre est une photo aérienne prise par l’armée ! Pour moi le Village Nègre est hautement symbolique, ou disons révélateur, de ce processus d’invisibilisation de la présence immigrée à l’échelle de l’agglomération lyonnaise. Il est un “non-lieu de mémoire” pour reprendre l’expression de l’historien Gérard Noiriel, c'est-à-dire un lieu qui ne sécrète plus aucune histoire. Bien entendu, je ne dis pas ici que ce processus d'amnésie est un processus conscient, organisé par des individus plus ou moins machiavéliques. Comme le dirait Bourdieu, le travail du sociologue n’est pas de dénoncer mais bien d’énoncer. Il ne s’agit donc pas de chercher des responsables à cette situation. Il convient plutôt d’en prendre note et d’en saisir les ressorts, les causes profondes. Aux États-Unis (pas la cité cette fois!), l’île d’Ellis Island par laquelle ont transité des milliers d’immigrés est devenue un musée. A Lyon, le Village Nègre a été rasé et effacé magiquement de la mémoire collective locale.
Bref ici, faire mémoire n’est pas chose facile pour les immigrés. Il leur est difficile de laisser une empreinte qui puisse leur garantir une quelconque visibilité historique. Ce qui pour le coup, est dommageable pour la compréhension de l’agglomération dans son évolution et dans son identité sociale. Il y a peu, je lisais un livre de 300 pages sur le peuplement et la naissance de Vénissieux. Sur ces 300 pages, 2 seulement évoquaient la présence étrangère !
Croyez-vous donc qu’il faille retravailler les contenus de la mémoire lyonnaise ? Dans quelle mesure d’ailleurs selon vous la mémoire peut aussi être un outil positif de la “gouvernance” ?
Pour commencer, je crois qu’effectivement, Lyon devrait s’efforcer d’entendre davantage la mémoire de groupes dont elle a sans doute fait trop peu de cas jusqu’à aujourd’hui. Ensuite il est certain que la mémoire constitue un des outils de la gouvernance. Mais cet outil est à double tranchant. Lorsqu’il consiste à imposer par le haut une mémoire octroyée, artificielle, embellie, afin de solliciter l’adhésion des individus en flattant leur narcissisme, il ne s’agit pas d’un outil très sain. C’est par exemple ce que font certains dirigeants qui mettent en avant la “culture d’entreprise” pour mieux renforcer l’esprit de corps des salariés (et accessoirement doper leur sens du sacrifice et du dévouement).
Pour Lyon, le danger est plutôt de développer une mémoire asphyxiante et hégémonique qui ne laisserait la place à aucune autre. Sans doute qu’en glorifiant de manière excessive certains aspects du passé, on s’interdit d’en voir d’autres. Or il ne faut pas sous-estimer les effets sociaux de l’amnésie.
Milan Kundera écrivait “Pour liquider les peuples, on commencera par leur enlever la mémoire.” Car la mémoire collective est constitutive d’une identité cohérente pour un groupe. Elle véhicule des normes, des enseignements, des symboles, fait savoir aux différents membres ce qu’ils sont de manière commune. Daniel Laumzfield dit qu’elle est autant un mémorandum (« rappelle-toi qui tu es ») qu’un mémento (« souviens-toi ce que tu as à faire »). La mémoire est surtout en cela une garantie de consensus et de cohésion sociale. Elle est une force centripète pour ainsi dire, et donc en cela une force extrêmement précieuse pour l’homme politique ou le gestionnaire, à condition toutefois qu’elle soit maniée avec circonspection. Quant à l’amnésie, a contrario, elle peut vite se transformer en instrument de domination à part entière quand elle fonctionne comme un analgésique puissant qui permet de légitimer un pouvoir. Il n’y a qu’à voir pour s’en convaincre, et toujours pour me référer aux États-Unis, le cas des Noirs américains privés de mémoire pendant de longues décennies et qui, pour se construire une nouvelle place sociale, ont du “désaliéner” souvent de force leur véritable histoire. Pour fonctionner comme un outil positif de la gouvernance, la mémoire doit donc être manipulée avec prudence. Oserais-je dire avec conscience ? Elle doit être plurielle et reconnaître les différents acteurs de la vie sociale. En aucun cas elle ne doit s’apparenter à un hymne qui chante les louanges d’une collectivité débarrassée de certains de ses éléments ; des éléments qui feraient du coup figure de “quantité négligeable” nonobstant la place objective qu’ils occupent dans le paysage économique, démographique ou culturel. Au moment où l’agglomération cherche à régler ses pendules à l’heure européenne et où, de surcroît, les enjeux de reconnaissance sont actualisés par l’obtention du prestigieux label de patrimoine mondial de l’humanité délivré par l’UNESCO, de nouveaux enjeux pèsent sur la construction et sur la mise en valeur de la mémoire lyonnaise. Et à l’orée du troisième millénaire, j’ose espérer que l’agglomération, sous l’impulsion volontariste de ses édiles, saura assumer la totalité de son histoire et qu’elle parviendra à se réapproprier la mémoire des événements générateurs des mouvements migratoires qui ont constitué sa population”.

Interview de Hervé FLEURY
"Comment redonner du sens à l’acte de manger ?"

Interview de Florian Fomperie
Directeur d’antenne de Radio Anthropocène
Une multitude de médias associatifs, locaux et citoyens pourrait-elle un jour constituer un rempart contre la désinformation et le manque d’indépendance des médias mainstream ?

Article
Quelles techniques et quels coûts pour traiter les micropolluants ?

Article
Découvrez les témoignages de figures marquantes de l’histoire du Défilé pour remonter à ses origines.
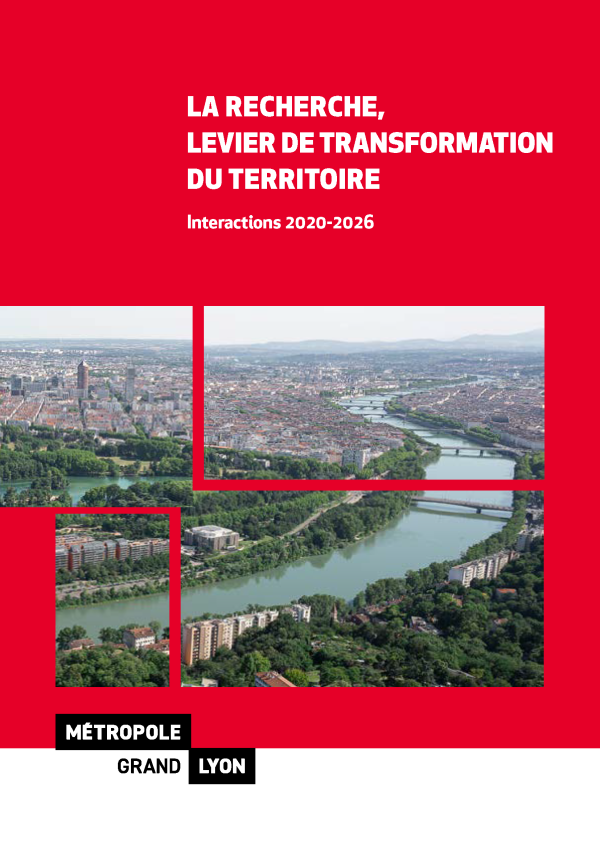
Étude
Aménagement du territoire, solidarités et santé, éducation, culture et sport : autant de champs d’action métropolitains qui ont fait l’objet de partenariats approfondis, détaillés dans ce document.

Étude
Les grands parcs apparaissent comme des espaces à part, qui proposent une nature organisée par l’homme et reflètent les préoccupations des époques qu’ils traversent.

Article
Issue de l’héritage du musée d’histoire naturelle de Lyon, le musée des Confluences n’a rien d’un long fleuve tranquille.
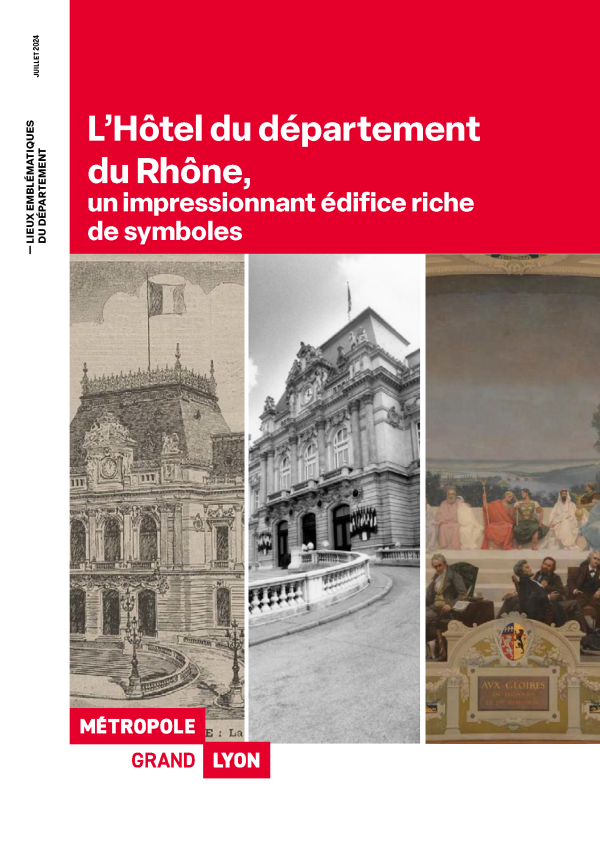
Étude
L’Hôtel du département du Rhône a la particularité d’abriter à la fois le Département du Rhône, collectivité territoriale, et la Préfecture du Rhône, service de l’État dans le département.
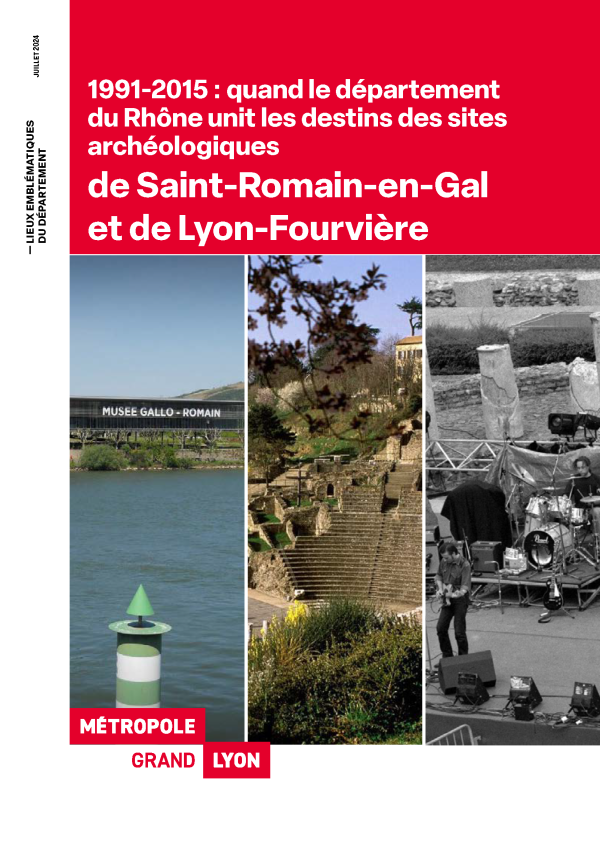
Étude
Dans le récit de la constitution des sites archéologiques de Saint-Romains-en-Gal et de Fourvière, prenons conscience de la valeur des traces civilisationnelles qui nous sont données à voir.